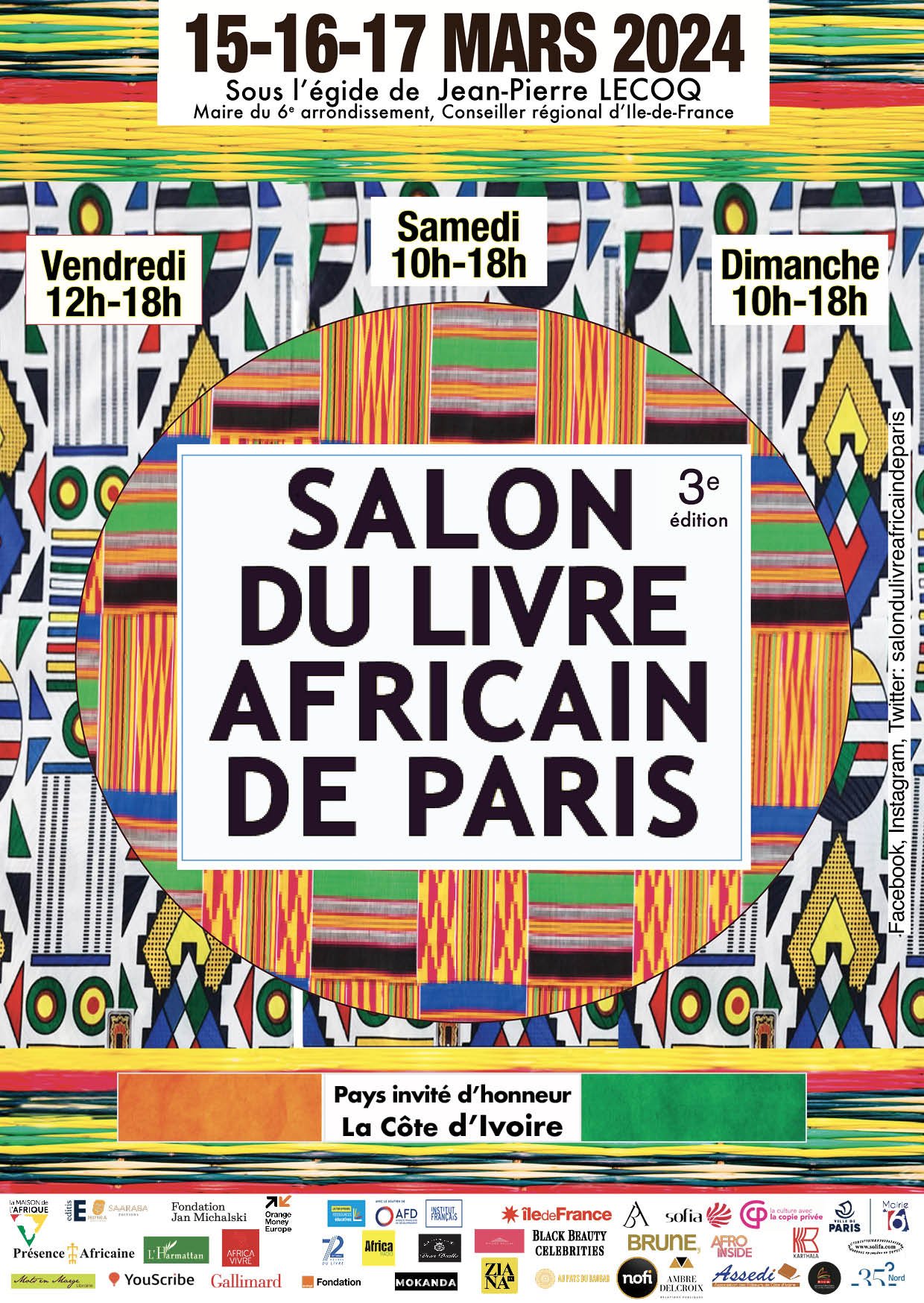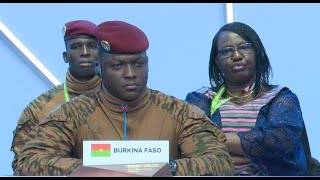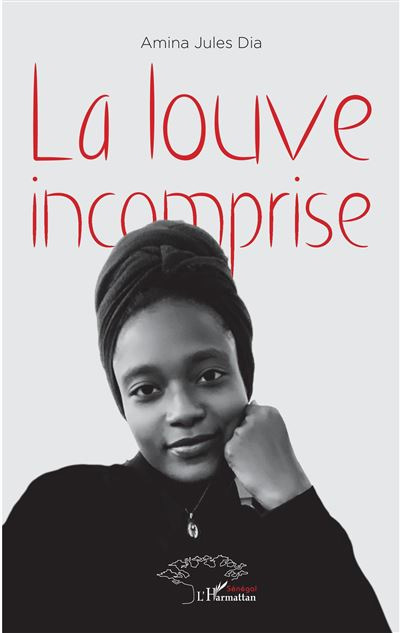ÉconomieTout Lire

« Le décrochage économique de l’Europe n’est plus une menace, c’est une réalité à laquelle il est urgent de s’attaquer »
- Le Courrier Africain
- 11.Fév.2024

Au Niger, mise en service d’un oléoduc géant vers le Bénin
- Le Courrier Africain
- 02.Nov.2023

Au Niger, mise en service d’un oléoduc géant vers le Bénin
- Le Courrier Africain
- 14.Nov.2023

Comment permettre aux femmes entrepreneures d’être aussi performantes que les hommes en Afrique
- Le Courrier Africain
- 05.Nov.2023
Société & Vie PratiqueTout Lire